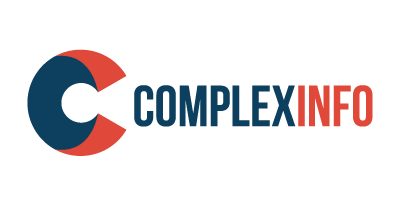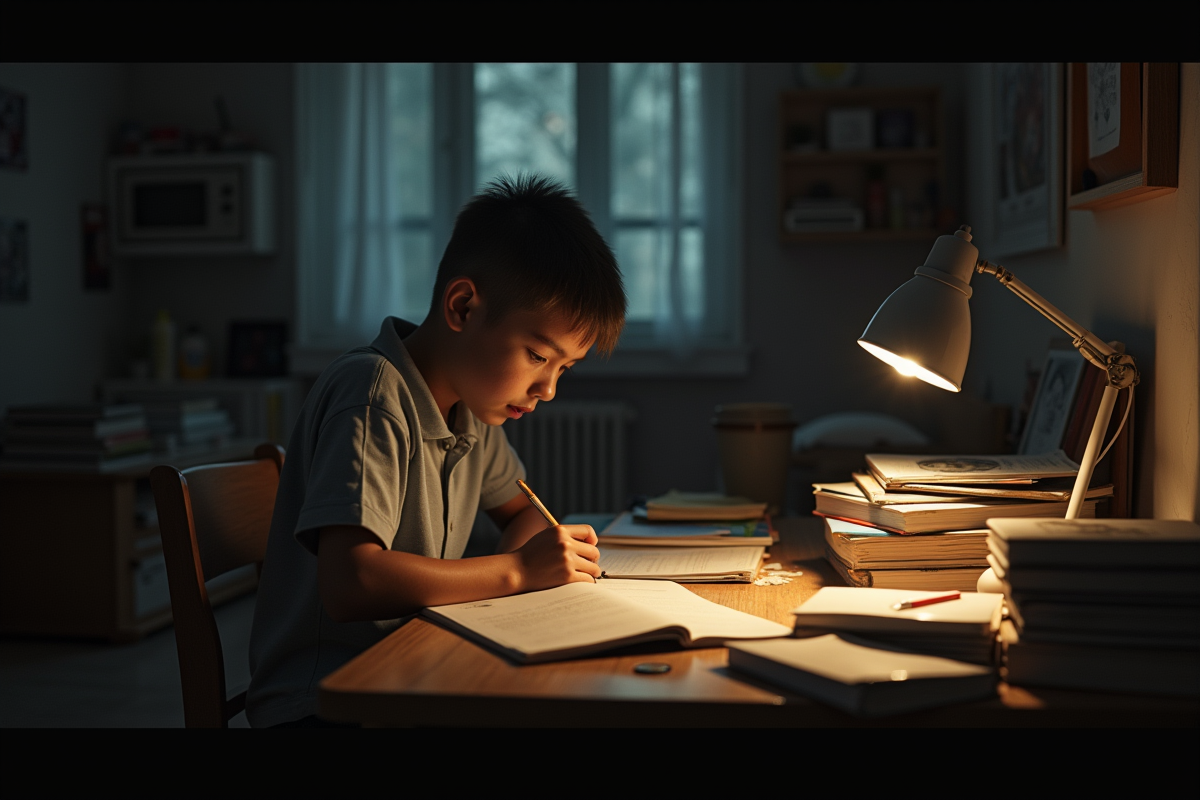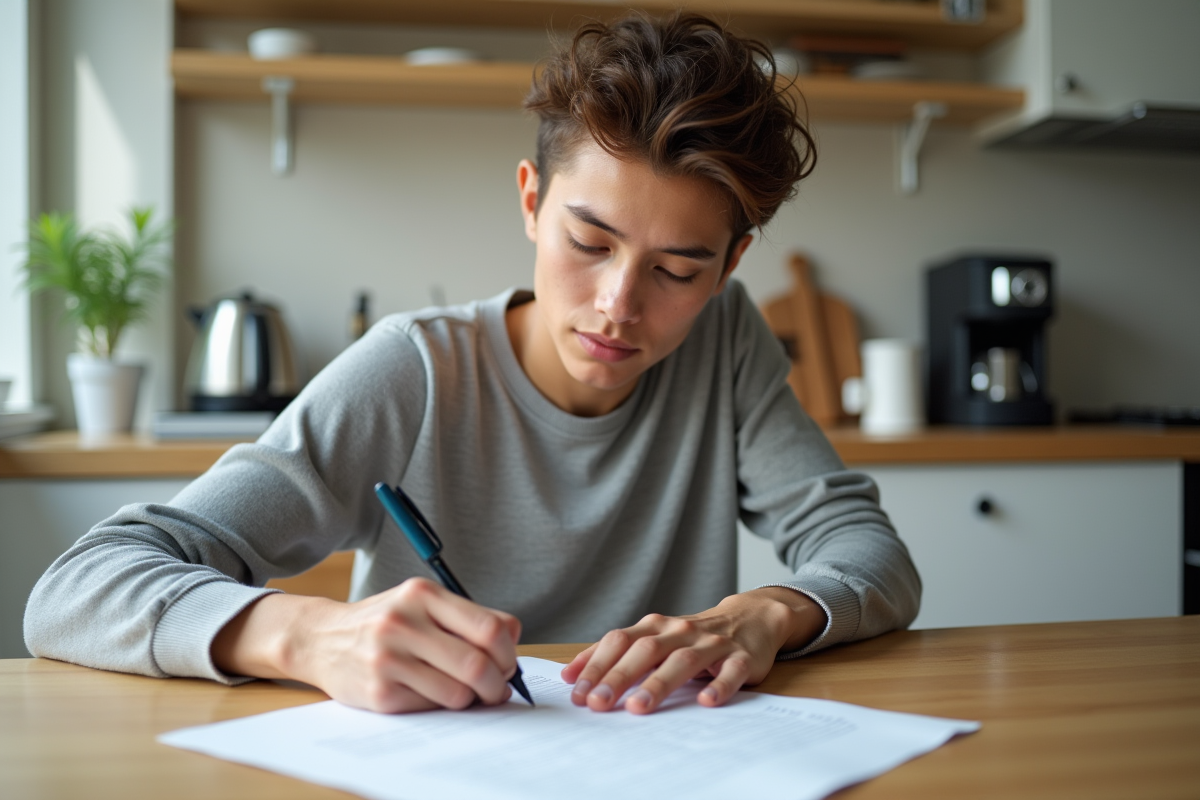En Somalie, moins de 30 % des enfants en âge d’être scolarisés fréquentent effectivement l’école. Le taux d’achèvement du primaire y reste l’un des plus bas au monde, entravé par des conflits, des inégalités de genre et une pénurie chronique d’enseignants qualifiés.
D’autres pays affichent aussi des résultats alarmants, malgré des dépenses publiques conséquentes ou des réformes annoncées comme ambitieuses. Les classements internationaux révèlent des écarts considérables et des situations inattendues, loin des stéréotypes habituels sur la réussite éducative.
Pourquoi certains systèmes scolaires échouent-ils ?
Les ratés des systèmes scolaires ne s’expliquent pas par un simple coup du sort. Ils s’installent sur la durée, alimentés par une série d’obstacles tenaces, souvent imbriqués. Première pierre d’achoppement : l’insuffisance des moyens. Quand l’État rogne sur le budget du ministère de l’Éducation nationale, les écoles se dégradent, les fournitures disparaissent et les enseignants s’essoufflent, mal payés et peu formés. L’accès à l’éducation s’effrite, la qualité suit le même chemin.
Ajoutez à cela l’instabilité politique et les conflits, et certains systèmes scolaires dans le monde basculent dans l’urgence permanente. Fermetures de classes, départs massifs d’enseignants, enfants déscolarisés, le droit d’apprendre se transforme en privilège réservé à une minorité.
Les fractures sociales et géographiques amplifient la crise : entre villes et campagnes, entre filles et garçons, entre familles aisées et précaires, la scolarité se vit à deux vitesses. Même à l’intérieur des salles de classe, l’échec s’installe. Programmes trop lourds, sélection précoce, absence de suivi personnalisé : l’écart se creuse, et le décrochage devient la règle plutôt que l’exception.
Voici quelques marqueurs éloquents de ces failles structurelles :
- Taux de non-scolarisation : plus de 30 % dans certains pays d’Afrique subsaharienne
- Résultats des évaluations internationales : scores inférieurs à la moyenne de l’OCDE dans les domaines de la lecture, des mathématiques et des sciences
Sans transformation profonde, les pires systèmes scolaires continuent de tourner en rond. Programmes inchangés, formation des enseignants au rabais, pédagogies figées dans le passé : autant de verrous qui enferment des générations entières dans la reproduction de l’échec.
Tour du monde des écoles en difficulté : entre manque de moyens et inégalités
À la marge du classement des systèmes scolaires dans le monde, certains pays cumulent les handicaps. Les chiffres ne laissent aucun doute : dans de nombreuses régions d’Afrique subsaharienne, plus de 30 % des enfants ne posent jamais le pied à l’école, selon l’UNESCO. Sur place, la réalité est rude : absence d’électricité, manque de manuels, enseignants sans formation. Les classes débordent, l’assiduité s’effrite, l’avenir éducatif semble hors de portée.
En Amérique latine, plusieurs États, tel le Honduras ou la République centrafricaine, figurent régulièrement au bas des classements des systèmes scolaires, malgré une stabilité politique relative. Les investissements insuffisants se traduisent par des bâtiments délabrés, des programmes inadaptés, des abandons massifs. Pour de nombreux enfants, les impératifs économiques prennent le dessus : travailler l’emporte sur apprendre.
En Asie du Sud, l’explosion démographique ajoute une pression supplémentaire. Les pires systèmes scolaires font face à des effectifs pléthoriques, à des enseignants mal préparés, à des contenus d’apprentissage dépassés. Au Bangladesh ou en Afghanistan, l’accès à l’école reste une loterie, particulièrement pour les filles.
Les réalités divergent, mais certains points de blocage reviennent sans cesse :
- Inégalités territoriales : fracture nette entre zones urbaines et rurales
- Accès à l’éducation : discriminations persistantes pour les minorités et les filles
- Ressources : matériel pédagogique manquant, salaires faibles, infrastructures dégradées
Dans l’ombre des statistiques, des millions de jeunes traversent leur scolarité sans perspective. Le manque, la discrimination et l’incertitude deviennent leur quotidien, bien loin de la promesse universelle de l’école.
Quel pays détient vraiment la palme du pire système scolaire ?
Derrière la façade des classements internationaux, la réalité bouscule : quel pays a le plus mauvais système scolaire au monde ? Les études PISA, pilotées par l’OCDE, font office de référence, mais elles laissent de côté les nations les plus fragiles, faute de données ou de moyens pour participer. Les résultats PISA mettent en lumière les différences entre membres de l’organisation, mais l’essentiel se joue ailleurs, loin des projecteurs.
Les chiffres sont clairs : des pays comme la République centrafricaine, le Soudan du Sud ou le Niger disparaissent tout simplement des classements. Dans ces régions, la scolarisation s’effondre, les enseignants manquent, la guerre ou l’instabilité politique dictent le quotidien. Pour des millions d’enfants, le droit d’apprendre reste une promesse non tenue.
Au sein même de l’OCDE, les écarts marquent les esprits. Si la France et le Royaume-Uni présentent des résultats dans la moyenne en lecture, mathématiques et sciences, plusieurs pays d’Amérique latine peinent à combler leur retard. Le Brésil, la Colombie ou le Mexique, présents dans les évaluations, se situent sous la moyenne OCDE et peinent à faire évoluer leur système scolaire vers les standards internationaux.
Au final, il n’existe pas de palmarès figé des pires systèmes éducatifs. Ce sont des contextes qui s’imposent : classes bondées, enseignants mal rémunérés, programmes hors-sol. Là où la misère éducative prospère, aucune statistique ne saurait tout dire.
Des pistes pour imaginer une école meilleure, partout dans le monde
L’école n’avance pas à coups de slogans, mais grâce à des décisions collectives et des choix politiques assumés. Les expériences les plus solides reposent sur des principes éprouvés : égalité d’accès, reconnaissance du métier d’enseignant, stabilité des programmes. Les pays nordiques, de la Finlande à la Suède, illustrent ce modèle : recrutement sélectif, autonomie pédagogique, effectifs réduits. Les résultats suivent.
D’autres territoires misent sur la formation professionnelle pour limiter le décrochage, notamment dans le secondaire. Au Canada, la diversité des parcours et la flexibilité des cursus marquent des points. L’innovation technologique peut aussi jouer un rôle, à condition d’éviter de renforcer les fractures. À Hong Kong ou en Nouvelle-Zélande, le numérique accompagne l’enseignement, mais ne remplace jamais la relation directe et l’accompagnement.
Voici quelques leviers concrets pour transformer durablement un système éducatif :
- Recrutement exigeant et formation continue des enseignants
- Accès universel à l’enseignement primaire et secondaire
- Investissements prioritaires dans les infrastructures scolaires
- Développement de la formation professionnelle adaptée au marché local
- Utilisation raisonnée des outils numériques
Comparer, c’est mettre à nu les écarts, mais aussi révéler les marges de progrès. Les politiques éducatives qui font la différence misent sur la cohérence, l’inclusion, l’écoute du terrain. L’école ne doit pas se figer. Elle s’invente, se questionne, se réinvente, laboratoire vivant, à la croisée des enjeux sociaux et politiques. Reste à savoir si, demain, chaque enfant aura droit à une salle de classe digne de ce nom ou si le rêve d’égalité restera une ligne d’horizon.